Tout le monde connaît les grandes lignes de l’aventure
épistémologique qui nous a menés, depuis le XVIIème siècle, aux
connaissances si vastes et précises dont nous disposons aujourd’hui sur notre
environnement et sur l’univers en général.
La science moderne, en tant que
méthode rationnelle d’investigation du monde réel, est objective et
culturellement neutre parce qu’elle sépare l’Homme de la Nature et le sujet de
l’objet. Elle s’oppose ainsi à ce que l’on nomme les
« ethnosciences » ou « savoirs traditionnels », corpus de connaissances
techniques et pratiques pouvant être logiques mais fortement marqués par un
certain nombre de postulats philosophiques, mythologiques, animistes,
subjectifs ou religieux. Il semble pourtant que ce récit doive être
complexifié. La philosophe et sociologue américaine Sandra Harding pose en
effet explicitement la question : la science moderne est-elle une ethnoscience ? Selon elle, l’examen philosophique, sociologique et
historique de ce problème permet d’affirmer qu'au même titre que les
ethnosciences, le noyau conceptuel des sciences modernes occidentales est
modelé par des postulats, valeurs et intérêts religieux, sociaux, politiques et
économiques. Elle précise bien sûr que « les sciences modernes peuvent
avoir une valeur universelle malgré la dimension culturelle de leur fondement
cognitif » et plus encore, que « les causes de cette validité universelle
sont à chercher (au moins parfois et en partie) précisément dans les postulats,
valeurs et intérêts locaux qui façonnent cette base cognitive ». Nous
avons déjà discuté sur ce blog
du fait que la séparation entre l’Homme et la Nature, le sujet et l’objet,
l’explication des phénomènes sur le mode disjonction/réduction, l’usage des
mathématiques comme formalisme univoque sont autant de postulats métaphysiques,
philosophiques ou culturels locaux. C’est ce que Nietzsche avait pressenti dès
la fin du XIXème siècle dans le célèbre paragraphe 344 du Gai Savoir (1882) intitulé
« en quoi nous aussi sommes encore pieux ». En voici un extrait :
«On voit que la science aussi repose sur une
croyance, qu’il n’y a absolument pas de science "sans présupposés".
Il ne faut pas seulement avoir déjà au préalable répondu oui à la question de
savoir si la vérité est nécessaire, mais encore y avoir répondu oui à un degré
tel que s’y exprime le principe, la croyance, la conviction "qu’il n’y a
rien de plus nécessaire que la vérité et que par rapport à elle, tout le reste
n’a qu’une valeur de second ordre" […] Mais on aura compris où je veux en
venir, c’est-à-dire au fait que c’est toujours sur une croyance métaphysique
que repose la croyance à la science, - que nous aussi, Hommes de connaissance
d’aujourd’hui, nous sans-Dieu et antimétaphysiciens, nous continuons
d’emprunter notre feu aussi à l’incendie qu’a allumé une croyance
millénaire, cette croyance chrétienne, qui était aussi la croyance de Platon,
que Dieu est la vérité, que la vérité est divine…»
Pour Nietzsche, les démarches d'établissement de «la
vérité» (c'est à dire la science et la religion en particulier) ont en commun
de constituer une fuite en dehors de nous-même et vers un «autre monde »
au-delà de ce qui est et advient «ici-bas». Un extérieur à notre vie, au-delà
de la physique, un monde métaphysique donc. Ces pratiques procédant de la
« volonté de vérité » se basent sur la croyance en une métaphysique
dualiste de la transcendance (donc du sauveur, du divin, du parfait, de l'idée
pure) qui provient de la vieille idée platonicienne selon laquelle Dieu est la
vérité et la vérité est le bien. Les phénomènes physiques naturels recèleraient en fait un ordre caché derrière le
hasard apparent, une
nécessité supérieure en partie accessible aux humains à la condition de pouvoir
connaître les desseins purs et abstraits du Logos divin. Nous avons vu
précédemment qu’il s’agit
là d’une croyance qui n’est pas nécessairement partagée par toutes les cultures
et notamment pas par la culture Chinoise classique. Nietzsche rappelle
d’ailleurs dans le paragraphe 109 du Gai Savoir que « c’est seulement aux
côtés d’un monde de buts que le terme de hasard a un sens ». Ce faisant,
il met en lumière le fondement de la métaphysique dualiste de la transcendance
qui contribue, selon lui, à développer une « croyance en la science »
comme méthode de dévoilement des essences du réel. Ainsi, la science serait une
réponse à un problème d’ordre moral, donc propre à une culture. Cette réponse
pourrait se formuler ainsi : la vérité révélée est unique et, dans nos
vies humaines, vaut mieux que la fausseté, le mensonge et la dissimulation. C’est
précisément cette croyance qui serait à l’œuvre dans la recherche de la vérité sur
un mode de pensée et de découpage du réel dualiste entre vérité et fausseté,
nature et culture, bien et mal. Or pour Nietzsche, nombre de ces clivages ne
tiennent pas, pire : ils nient notre existence et nos vies humaines. C’est
pourquoi la plus imposante moustache de la philosophie occidentale nous enjoint
à vivre et penser « par-delà le bien et le mal », à pratiquer le Gai
Savoir, la « Gaya Scienza » des troubadours. Il s’agit une manière
enjouée d’être au monde, faisant de celui qui la pratique à la fois un poète,
un chevalier et un chercheur, en regroupant l’art, la joute et la connaissance.
Enfin, la prétention des sciences modernes à la
neutralité suffit en elle-même à la désigner comme culturellement marquée,
voire comme spécifiquement occidentale. Quiconque se revendique libre de toute
valeur revendique la norme et pose l’autre comme différent, particulier par
principe. Sandra Harding explique :
«La plupart des cultures en effet ne
prônent pas la neutralité ; elles valorisent leurs postulats confucéens ou
indiens, ou musulmans ou maori… Quiconque revendique la neutralité se trouve
dès lors aisément identifiable. D’autre part, cette prétention à la neutralité
est caractéristique des administrateurs des cultures modernes, organisées selon
les principes de la rationalité scientifique […] L’abstraction et le formalisme
expriment des traits culturels spécifiques, et non l’absence de toute culture.
A cause notamment de ces caractéristiques, la science moderne est perçue comme
une intrusion culturelle brutale lorsqu’elle est injectée dans d’autres
cultures.»
Tout en reconnaissant l’étendue universelle du
champ d’action des sciences modernes, il est donc primordial de prendre
conscience de leurs idiosyncrasies culturelles. Autrement, nous courons le
risque de perpétuer d’anciens rapports de domination en martelant encore et
toujours la neutralité et l’objectivité comme arguments d’autorité. Dans cette
optique, l’éducation joue un rôle prépondérant. L’enseignement quasi-exclusif
d’un formalisme privé de son substrat philosophique entraîne une anamorphose
conceptuelle qui altère et déforme jusqu’à l’horreur toute compréhension
historique et culturelle des pratiques scientifiques. Ce qui débouche finalement
sur l’illusion de sciences dont la validité et l’efficacité relèvent du
magique, du « cargo cult ». Ainsi, paradoxalement, c’est lorsque
l’on considère les sciences comme absolues, souveraines et immuables que l’on
fragilise le plus leur diffusion et leur compréhension par le public, car ces stéréotypes
débouchent sur une forme de pensée magique qui contredit l’essence de la
démarche scientifique.
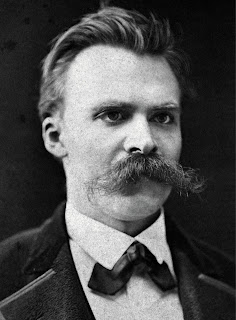
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Saisissez votre commentaire.